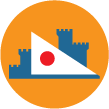Voilà une aventure qui donne à réfléchir mais qui n’a pas commis la même erreur?
généralement sans conséquence….
Laissons parler le héro du jour:
Une drosse de barre qui casse
Avant de quitter Marseille, mon port d’attache, j’ai pris soin de tout vérifier : mât et gréement sont neufs, le moteur a été révisé et une croisière en Grèce, l’été précédent, m’a permis de corriger les derniers points faibles. Par négligence toutefois (et aussi parce qu’un changement total n’est pas simple à effectuer sur un Sun Fizz), je me suis contenté d’une inspection visuelle et d’un graissage des drosses du système de barre. C’est une erreur, car, le principe de Murphy étant aussi incontournable que celui d’Archimède, l’une d’elles choisit précisément de lâcher au milieu du canal.
Pas grave. Le pilote, dont le vérin travaille directement sur le secteur, me permet de reprendre immédiatement la main le temps de gréer la barre franche de secours (ridiculement courte) pour reprendre le bon cap…
Chercher ce qui a cassé
Le coffre arrière qui permet d’accéder aux drosses de barre Quelques heures plus tard, les bras et les épaules un peu fatigués, j’arrive à Rodney bay, immense plage au nord de Sainte-Lucie où je pose l’ancre sur le sable par cinq ou six mètres de fond. La mer est plate comme la main et mon plus proche voisin se trouve à une bonne centaine de mètres : nous ne risquons pas de nous toucher ! J’envoie, comme il se doit, la boule de mouillage et le pavillon Q puis, sans prendre le temps de redéployer le bimini, franchement curieux, je m’apprête à vérifier si la drosse est effectivement cassée ou s’il s’agit, comme je l’espère, simplement d’un serre-câble à reprendre. Nous sommes en milieu d’après midi et je me promets, après tout cela, une baignade bienvenue avant la douche…
Au fond du coffre pour réparer
Pour accéder au secteur de barre, il me faut vider le coffre qui sert de siège au barreur et en ôter le fond. Mais avant cela, je dois d’abord enlever une boîte de stockage des bouteilles de gaz que j’ai aménagée. Elle est équipée d’un tuyau de mise à l’air libre qui rejoint celui d’origine situé dans le coffre bâbord. Après avoir vidé ce dernier, muni d’un tournevis et d’une lampe frontale, je m’y glisse pour desserrer le collier… Sur les voiliers de cette époque, les capots de coffre sont équipés de simples charnières à cadenas : une plaque de laiton percée d’une lumière qui se rabat sur l’anse fixée contre la paroi du cockpit. J’ai, bien sûr, des mousquetons frappés sur les filières pour sécuriser les capots en position ouverte, mais nous sommes sur un vrai lac… Je n’en ai que pour trois minutes… Négligence ? Inconscience ?
Enfermé dans le coffre !
La suite, vous la devinez sans peine : un petit coup de roulis sans doute causé par le passage d’une annexe et, patatras, le capot retombe, la charnière à cadenas bascule dans une élégante rotation et se referme sur l’arceau. Clac ! Tout devient noir ! Je suis enfermé dans mon coffre arrière bâbord, seul à bord, par 35°C à l’ombre au milieu du mouillage de Rodney Bay. Brassens, dans sa chanson pour Marinette, décrivait parfaitement de quoi j’avais l’air avec ma lampe sur le front et mon petit tournevis à la main… Dans ce genre de situation (j’ai la désagréable impression d’être un rat de laboratoire observé par un éthologue taquin), la première réaction viscérale consiste à se démener tous azimuts.
Animal, c’est ce que je fais. Pour rien. Les écrous des boulons du verrou-charnière sont, soit masqués par le surbau, soit noyés dans le polyester. Je lorgne du côté des charnières de la partie haute, même chose. Le seul truc que je réussis à faire est de casser mon tournevis en essayant d’écarter le bas du capot. Saleté… Je commence à transpirer, l’air devient lourd et poisseux. Par chance, je ne suis pas claustrophobe et plus de quarante ans de plongée m’ont appris à vivre en milieu confiné (quelques semaines plus tard, les trois quarts du monde devront s’y mettre, mais c’est une autre histoire…), il n’empêche : je ne vois pas les prochaines heures d’un œil optimiste, recroquevillé dans un coffre où je ne peux ni m’allonger ni me redresser, sans eau et avec une ventilation minimale.
Le temps passe… Réflexions…
Deuxième phase sous l’œil de l’éthologue décidément pervers : je me pose et réfléchis. Mon Iridium-Go est en route et mes proches savent au mètre près où je me trouve. Bonne pioche… Oui, mais cela ne m’avance guère, car il va falloir attendre au moins quarante-huit heures avant que l’inquiétude ne les gagne. Peut-être même un peu plus… Et que vont-ils imaginer ? Un portable en panne ? Après tout, je suis au mouillage dans un coin tranquille… Le temps de réaliser que j’ai effectivement un problème, de mettre en place une procédure de sécurité, je devrais attendre au bas mot soixante-douze heures.
Et encore… Bon… J’ai mis le pavillon jaune, peut-être les douaniers vont-ils passer ? Je n’ai pas de montre, mais, à vue de nez, les bureaux doivent être déjà fermés. Nous sommes dans la Caraïbe. Ici, peut-être plus qu’ailleurs, les gabelous maîtrisent parfaitement l’art subtil de l’overtime. Pas avant demain… S’ils viennent… Et si je criais ? Soit. Je crie. En vain : autant garder mon souffle, le vent porte au large, les voisins sont trop loin… Que faire ? La bouteille de gaz ? Je reviens à la première phase d’agitation en la démontant ainsi que son robinet dont j’essaie de me servir comme d’un levier. Le robinet casse. C’est bien la seule fois de ma vie de marin où je reproche au chantier Jeanneau d’avoir construit un peu trop costaud… On ne pleurait pas la matière en 1980… Même la cloison côté cabine est indestructible. Je prends la bouteille de gaz et cogne comme un sourd sur le fond du capot, mais je suis à l’étroit et mes mouvements n’ont pas assez d’amplitude.
Inefficace, inutile et fatigant. L’air s’épaissit encore et ma bouche devient pâteuse. Les minutes s’étirent, longues et poisseuses. Je sue à grosses gouttes… Angoisse… Le coffre se referme sur Pierre… Et dire que mon téléphone est à moins de trois mètres, posé bien en évidence sur la table à carte ! Je peux bien aujourd’hui le confesser : sournoisement, l’angoisse me gagne. Ai-je d’autres choix que celui d’attendre la survenue d’un hypothétique secours ? Dans vingt-quatre ou quarante-huit heures (je n’ose envisager davantage), dans quel état serai-je ?
Une image me frappe. Je me souviens, plongeur perdu par le bateau de surface, avoir dérivé près de six heures sur le banc du Geyser, dans le canal du Mozambique. La première terre était à plus de cinquante milles et nous étions au début des années quatre-vingt. Il n’existait alors ni parachute de signalisation ni, a fortiori, de moyen électronique de repérage. J’ai eu peur, mais que faire ? Attendre en s’économisant et en se rappelant tous les bons moments. J’avais alors listé et ressassé tous les êtres, les endroits, les plats que j’avais aimés. Une technique pour ne pas penser au pire. Finalement, j’ai été récupéré à la nuit tombée grâce à mon flash d’appareil photo que j’actionnais à intervalle régulier. Ce soir-là, en remontant l’échelle perroquet du vieux thonier qui roulait dans la houle du large, je suis né une deuxième fois grâce au regard d’aigle d’un jeune marin malgache. Aujourd’hui, même sans la menace des requins longimanes, je réalise que ma situation est bien pire parce que personne ne me cherche…
Action… Il existe, dit-on, deux sortes de stress : le bon et le mauvais. Celui qui annihile et celui qui sauve. Aiguillonné par un solide instinct de survie, j’oublie mes listes positives pour entrer dans une troisième phase, celle de la rage. J’ai envie de hurler. C’est trop bête ! Il doit bien y avoir une solution ! j’ai alors conscience qu’il me faut tenter le tout pour le tout avant d’être épuisé par la déshydratation. C’est maintenant ou jamais. Le dos appuyé dans la longueur de la coque (en travers, ce serait impossible), jambes repliées au-dessus de moi, les pieds à plat contre la partie horizontale du capot, je décide de donner tout ce que j’ai.
La position n’est pas idéale (si j’ose dire), car la coque est naturellement très inclinée dans sa partie arrière et je ne travaillerai pas de manière symétrique. Tant pis. Je respire bien et force une première fois. Rien. Une deuxième fois. Rien encore. Ce coup-ci, Pierrot, c’est le dernier, le rat doit sortir de sa cage. Je mets dans mes cuisses tout ce dont je suis capable… Le Bien, le Mal et toutes mes tripes. Je veux sortir ! Mes jambes tremblent, une douleur traverse mes lombaires… Je force comme s’il s’agissait d’une troisième naissance et, soudain, le verrou lâche ! Alors, frappé d’étonnement, le souffle court, je vois le ciel et les petits nuages pommelés qui rosissent. Mes vertèbres sont en compote, c’est sans importance : une bouffée de bonheur m’envahit.
Le verrou a lâché !
 Heureusement, le verrou à cassé Maintenant que les mois ont passé, je suis incapable d’évaluer la durée de mon enfermement. Une heure, deux peut-être ? Quand je me suis redressé, le soleil était déjà bien bas. Avec difficulté, j’ai enjambé le rebord du cockpit et j’ai vu que le verrou s’était tout simplement rompu dans la partie boulonnée au capot. Sans doute fatiguée par les coups de tournevis et de robinet, la plaque de fixation s’est déchirée, les trous de vis constituant des amorces de rupture bienvenues. Après ce rapide constat, courbé comme un vieillard, j’ai englouti le contenu d’une bouteille d’eau puis je me suis baigné. L’eau était bleue, chaude et diaphane. Enfin, plus tranquillement, je me suis préparé un planteur que j’ai senti et goûté comme s’il contenait la destinée de l’univers. Et je crois bien que c’était le cas. Malgré un dos ruiné, j’étais heureux, j’étais en vie. Moralité : toujours assurer les portes de ses coffres…
Heureusement, le verrou à cassé Maintenant que les mois ont passé, je suis incapable d’évaluer la durée de mon enfermement. Une heure, deux peut-être ? Quand je me suis redressé, le soleil était déjà bien bas. Avec difficulté, j’ai enjambé le rebord du cockpit et j’ai vu que le verrou s’était tout simplement rompu dans la partie boulonnée au capot. Sans doute fatiguée par les coups de tournevis et de robinet, la plaque de fixation s’est déchirée, les trous de vis constituant des amorces de rupture bienvenues. Après ce rapide constat, courbé comme un vieillard, j’ai englouti le contenu d’une bouteille d’eau puis je me suis baigné. L’eau était bleue, chaude et diaphane. Enfin, plus tranquillement, je me suis préparé un planteur que j’ai senti et goûté comme s’il contenait la destinée de l’univers. Et je crois bien que c’était le cas. Malgré un dos ruiné, j’étais heureux, j’étais en vie. Moralité : toujours assurer les portes de ses coffres…
Pierre Martin Razi